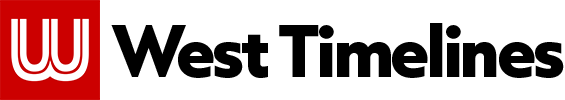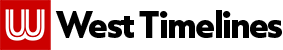Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Hors-série. Les Français traversent, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale décidée le 9 juin 2024 par Emmanuel Macron, une crise inédite sous la Ve République. Une nouvelle poussée de « fièvre hexagonale », pour reprendre le titre du livre de l’historien Michel Winock (Calmann-Lévy, 1986), qui traite des crises politiques de la France depuis la fin du XIXe siècle. Dans cet ouvrage, devenu une référence, le spécialiste d’histoire contemporaine en propose une définition restrictive : « Ce sont les grandes perturbations qui ont mis en danger le système de gouvernement républicain. » Vivons-nous vraiment un moment de « grande perturbation » susceptible de « mettre en danger » la République ? Progression de l’extrême droite, montée des populismes, absence de majorité à l’Assemblée nationale, instabilité gouvernementale… Une zone de turbulences secoue bien le territoire national, et tout porte à croire qu’elle est loin de s’arrêter. Même si l’année 2024 s’est terminée sans budget pour l’Etat, les institutions fonctionnent normalement et l’administration tourne. Alors, que se passe-t-il depuis la dissolution ? Dans son hors-série « La République sous tensions, 1870-2025 autonomie des crises politiques » (100 pages, 12,50 euros), qui alterne entretiens, portraits, décryptages, analyses et enquêtes, Le Monde a décidé de visionner en boucle le film politique qui déchire dirigeants et partis depuis près d’un an, et qui interroge les opinions publiques en France et en Europe, au point que, pour l’ancien premier ministre italien Enrico Letta, la France est en crise car elle « paie une grande erreur, celle du passage du septennat au quinquennat ». Les outils de la Ve République sont-ils en cause ? Empêchent-ils la vie politique de fonctionner ? Si la raison de la « grande perturbation » actuelle est vraiment institutionnelle, un seul changement des règles du jeu peut-il servir de remède à tous les maux ? Le concept de « république » Alors que les débats autour du mode de scrutin ou d’un changement de Constitution animent tous les partis, une évolution des modalités peut-elle servir d’antidote à la crise de confiance que traverse notre démocratie ? Qu’est-ce qui, des règles ou du jeu, est remis en cause ? Et si c’était la pratique du pouvoir, plutôt que les règles qui la régissent, qui posait problème ? Dans ce cas, n’est-ce pas le concept de « république » en tant que projet qui pose question pour les citoyens et citoyennes, sans que jamais sa légitimité soit remise en question ? Serait-on alors entré dans ce que l’essayiste Alain Duhamel appelle « une crise systémique » ? Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Crise politique ou crise de régime, la Vᵉ République vacille Lire plus tard Parmi les démocraties libérales, la France, avec sa tectonique des plaques politiques, apparaît comme une exception selon laquelle « les crises politiques peuvent déboucher sur une crise de régime », relève l’historien britannique Julian Jackson. Pour bien saisir cette singularité française, se pencher sur la « reine mère » des Républiques, la IIIe (1871-1940) – connue pour sa longévité, la puissance de ses lois et l’autorité de ses hommes – nous aide à comprendre le présent et à éclairer l’avenir. « Notre » avenir, plus précisément, car « la République, c’est nous », citoyennes et citoyens invités à nous accorder autour d’un tronc commun pour refaire nation et échapper ainsi à une bien plus forte poussée de « fièvre hexagonale » qui ne dit pas encore son nom, mais qui aurait les symptômes d’une crise de régime. « La République sous tensions, 1870-2025 autonomie des crises politiques », hors-série, 100 pages, 12,50 euros. LE MONDE Gwennoline Le Cornec et Gaïdz Minassian Réutiliser ce contenu